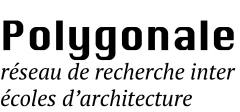Introduction de la Polygonale 13 à Nedde, sur le plateau de Millevaches.



En avant-propos, une écoute de la Transcription musicale de la structure des arbres, de Giuseppe Penone
« Le mythe est collectif et il enchaîne à lui les masses (…) tandis que l’utopie est individuelle et critique (…) Le mythe, c’est l’ouverture d’un avenir collectif, l’espoir projeté par un groupe qui perçoit comme intolérable le monde tel qu’il est et cherche à inventer un nouveau récit collectif. [Pour l’utopie] l’ordre des possibles ne suffit pas, il nous faut dès lors penser l’impossible, aller au-delà des faits en récusant le jeu des faits. [1]»
Ce qui désigne notre Polygonale nouvelle, c’est toujours ce par quoi nous avons achevé la précédente, et qui se trouvera déplacé/déporté par celle-ci à la prochaine édition – si tant est qu’elle ait lieu[1]. Ainsi en va-t-il de ce « Commun n’est pas collectif » fonctionnant comme manifeste rétroactif de la Polygonale 12, et comme argument programmatique pour nos travaux présents sur le plateau de Millevaches.
Commun n’est pas collectif
Soit l’affaire du collectif, telle qu’analysée par Elias Canetti, dans son Masse et Puissance, et les appareils urbains dont elle aura en conséquence lourdement doté notre XXème siècle (même si le concept n’est chez cet auteur pas nécessairement épochal). Si la masse est « ce par quoi les hommes apeurés s’unissent et forment une collectivité[2]», elle peut se décliner sous la figure symétrique de « masses compactes » placées sous l’emprise du tyran « qui uniformisent et dans lesquelles les individus se dé-singularisent », et de « masse de refus » qui expriment un désir d’émancipation, mais peuvent aussi bien se révéler devenir à leur tour coercitives.
Soit l’enjeu du commun tel qu’entrevu par Joëlle Zask, sans que la philosophe n’en vienne véritablement à le nommer comme tel, dans Quand la place devient publique.
« [De cette fonction des] places publiques [qui] est de constituer non un « espace » où le pouvoir domine, mais un lieu où s’expérimentent la sociabilité démocratique et le cortège de « vertus » qui l’accompagnent. Elle est d’accueillir des publics en recherche d’eux-mêmes, non des foules ou des masses.[3] »
Dans les applications respectives de ces notions à la chose publique, différence en quelque sorte, entre places du pouvoir (sur autrui) et places de la puissance (d’agir).Pour Pierre Dardot et Christian Laval, si le commun est « principe politique » et « praxis instituante », Il importe pour autant d’établir tout à la fois un parallèle historique et une différence fondamentale entre commonisme et communisme. Au point d’y consacrer un chapitre entier de leur Commun[2]. Tandis que Peter Sloterdijk n’a de cesse de distinguer – au terme des trois volumes de sa sphérologie – le communisme (de l’âge du Globe), du co-immunisme (auquel nous conduit l’âge des écumes).
Ce commun n’est pas collectif signifie donc dans notre esprit – comme notre session de Saint-Etienne l’a montré – qu’est derrière nous le choc des deux trajectoires massifiantes du capitalisme des âges premiers et des contre-pouvoirs collectivistes ; en ces temps où à l’expression verticale de l’autorité des patronats, s’opposaient les non moins hiératiques organisations syndicales. Aussi ce présent retour des communs revêt-il un sens qui n’a rien d’une épiphanie du collectif.
Pour autant, passée cette longue « parenthèse » de l’âge moderne », le commun nous est revenu différent de celui de ses lointaines origines antiques et médiévales. Si est toujours en jeu le partage équitable de « choses » au sein d’une communauté donnée, les motivations démocratiques de l’équilibre faisant ce partage sont devenues essentielles[3]. Si la substance du commun demeure matérielle – quelle qu’en soit la nature, fût-elle désormais souvent informationnelle – sa visée s’inscrit plus que jamais dans le champ politique.
Les conflits des enclosures sont aussi anciens que l’existence des communs. Pour autant ce qui relevait autrefois de résistances liées à une fragile économie de subsistance, voire de survie, prend un autre relief à l’heure où l’institution de communs tangibles les adosse presque toujours à leurs pendants informationnels. Le commun est praxis et logos, production et savoir, expérience et manifeste de cette expérience. Comme tel, il est à la fois instrument et support de connaissance. Les expériences dont il relève n’ont de cesse de discuter le régime économique dominant en lequel et/ou contre lequel elles se font jour. Que ce soit en interne, dans le registre de la subversion, ou à l’air libre, sous des formes clairement oppositionnelles, elles se présentent comme alternatives aux régimes libéraux ou néo-libéraux nous gouvernant.
Enfin ce commun n’est pas collectif non plus, dans ce sens courant dont on abuse aujourd’hui, quand s’entendent louer benoîtement les vertus des collectifs de travail – sans trop savoir qu’y placer (sinon des formes un peu vagues d’horizontalité organisationnelle au sein de l’entreprise) ou l’ubérisation explicite ou rampante de l’économie dite collaborative.
On se reportera à ce sujet aux travaux d’Antonio Casilli sur le travail numérique[4]. Ou aux recherches de Marianne Dujarier sur la nouvelle sociologie du travail[5]. Ainsi, dit cette autrice en substance, dans le stock vaste et fourre-tout de l’économie collaborative, on trouvera beaucoup « d’autoproduction dirigée » (nous voilà coproducteurs de notre fournisseur, ainsi de ces services d’achat à distance ou machiniques dont l’édition revient entièrement au client), beaucoup aussi de « coproduction collaborative » (nous voici fournisseurs d’un service dont les professionnels sont absents, sinon au titre de la rente – ainsi en va-t-il de l’économie des plateformes), pour au final bien peu de « collaboratif militant ».
Le commun d’une communauté biotique
Mais une autre question se profile aussi aujourd’hui, qui nous fait approcher la situation du plateau de Millevaches.
Si nous venons de rappeler que selon Elinor Ostrom, les communs relèvent de ressources naturelles ou artefactuelles, de règles établies pour les mettre en partage, et de la délimitation d’une communauté pour en jouir ; si Benjamin Coriat estime à sa suite que les communs sont, au sein d’une communauté donnée, stock de ressources, droits et obligations et modalités de gouvernance ; comment caractériser cette communauté ? Et que faut-il comprendre et accepter par « ressources » ?
« Dans la théorie des communs, il faut supprimer la ressource et considérer que les éléments non humains entrent dans une communauté biotique.[6] »
Que cela soit par le truchement de son blog, ou lors d’interventions publiques[7] Lionel Maurel s’est à de nombreuses reprises interrogé sur le bien-fondé de cette notion, telle que placée au cœur de l’approche économiste du commun. Ce, pour critiquer la perspective extractiviste dont elle relève, en la replaçant dans le faisceau des ontologies dualistes, qui ont été et sont toujours en phase avec le système d’exploitation coloniale du système Terre légué par l’âge moderne (sujet vs objet, nature vs culture, humains vs non humains, etc.). En leur préférant les ontologies relationnelles, inscrites pour leur part dans des milieux ou communautés biotiques, dont Aldo Leopold a le premier décrit l’existence.
De repenser donc de la sorte le commun par ce relationnel. Et de relever le cas de ces entités mésologiques, comme la Pachamama en Bolivie, où « une diplomatie ontologique se voit constitutionnalisée », soit cette figure de la Terre Mère, une sorte de divinité laïque permettant à tous les acteurs concernés de s’entendre par/sur l’identification d’un milieu commun à préserver.
Si nous allons visionner lors de cette Polygonale Le temps des forêts[8], qui acte l’émergence d’actions citoyennes se réappropriant et ménageant ces écosystèmes fragiles, je voudrais signaler cet autre film, Le chant de la terre (Brésil, 2019), fonctionnant en miroir, comme le spectre inquiétant d’un héritage/terroir empêchant les êtres d’accomplir leur individuation, (du fait dans le cas présent du pouvoir trop prégnant du chamane). Cela pour éviter le piège d’une définition trop simple du commun, et d’une relation trop évidente à l’identité.
La question de la limite est en effet centrale dans la définition d’un commun. Comment peut-on la franchir ? Dans quelle mesure la communauté est-elle accueillante ? Quelle balance penser entre l’inclusivité (qui est le propre des communs ouverts) et l’exclusivité (qui en protège la nature, Ostrom érigeant ainsi au premier de ses principes, l’identification d’une limite) ? Dans quelle mesure et jusqu’à quel point – dans le cas des communs oppositionnels – l’appropriation d’un sol, d’un territoire, est-il légitime ?
Ainsi Serge Gutwirth et Isabelle Stengers préviennent-ils contre « l’idée-repoussoir de communautés statiques, conformistes, dominées par un contrôle social oppressant, excluant toute divergence, définissant comme étranger ce qui n’est pas elles-mêmes [comme n’ayant] rien à voir avec les commons contemporains pour lesquelles ce que Capra et Mattei appellent “générativité” est en elle-même un enjeu[9] ».
Ainsi s’agit-il de penser une relation à ce commun qui ne soit pas manichéenne – qui passe par la possibilité pour une personne de repenser plus généralement sa relation au monde.
Soit un milieu qui se construit à tout moment – qui joue de cette relation du local en se donnant aussi la possibilité d’habiter une échelle plus étendue.
Milieux du commun _ une trajectoire Polygonale
Bruxelles, Marseille, Grenoble, Saint-Etienne… la séquence récente de l’aventure Polygonale peut être vue comme une lente migration, au sein de la problématique du commun, vers et en le milieu. Ce que consacre notre arrivée sur le plateau de Millevaches. Jardins partagés, fermes urbaines, « écoquartiers », « agrocités »… la pensée de l’urbain ne cesse d‘associer aujourd’hui la question de l’habiter en milieu dense, avec les enjeux d’une économie vivrière qui lui serait adaptée et, pour laquelle le monde rural fait à certains égards figure de modèle[10]. Comment habiter le commun – telle est la question. Le métier de vivre[11], tel que brandi comme expérience à Notre-Dame-des-Landes, relève d’une affirmation militante – rien ne saurait compter davantage que de savoir habiter – et d’une utopie ruraliste – loin de la ville, tout (re)devient possible.
Ainsi avons-nous été fréquenter les prémisses d’une expérience d’habitat participatif aux Herbeys près de Grenoble (Polygonale 11), puis sommes-nous descendus sur les traces de la vallée industrieuse du Gouffre d’Enfer, en amont de Saint-Etienne (Polygonale 12) – et sommes-nous aujourd’hui sur le point d’arpenter la forêt de Millevaches.
J’ai d’abord vu pour ma part la conceptualisation du milieu se former en trois temps. Sur le milieu « naturel », avec le biologiste Jacob von Uexküll, et son concept d’Umwelt, selon lequel chaque espèce vivante a son univers propre, qu’elle constitue en lui donnant sens, et qui lui impose dans le même temps ses déterminations[12]. Avec le géographe Augustin Berque, ou plutôt sur ce qu’il nous transmet, en sa qualité de traducteur et passeur avisé, de la philosophie de Watsuji Tetsurô sur la notion d’écoumène, au sens du monde habité par la communauté des humains[13] (mais cette acception étroite n’est-elle déjà en partie en déphasage avec ce que nous apprend l’écopolitique d’une conception élargie du milieu aux non humains ?). Enfin sur le milieu associé de la machine et de l’environnement avec lequel elle fait corps, avec le philosophe Gilbert Simondon[14].
Trois ouvrages sont apparus récemment, dont le statut, la « nature », l’enseignement ont déclenché quelque chose de très puissant – chacun à son niveau de complexité relatif et à l’égard de son audience particulière – dans des effets échoïques entre monde scientifique, acteurs des milieux habités, et grand public.
Avec l’ouvrage du forestier Peter Wohlleben : La vie secrète des arbres Ce qu’ils ressentent Comment ils communiquent Un monde inconnu s’ouvre à nous, 2017 (ed.orig. 2015). Avec celui du philosophe Emanuele Coccia : La vie des plantes Une métaphysique du mélange, 2016. Avec celui de l’anthropologue Eduardo Kohn : Comment pensent les forêts. Vers une anthropologie au-delà de l’humain, 2017 (ed. orig. 2013). Si les deux premiers ont pu depuis lors voir critiquée leur capacité à transposer un peu littéralement ce que nous savons du vivant nous concernant, vers ce que d’autres espèces ont de spécifique[15] – l’ouvrage de Kohn s’en prend – tout spécialiste de cette discipline qu’il est – aux fondements même de l’anthropologie en questionnant nos conceptions de ce que cela signifie d’être humain, et distinct de toute autre forme de vie. En explorant la manière dont les Amazoniens interagissent avec les diverses créatures qui peuplent l’un des écosystèmes les plus complexes au monde. Ainsi le mouvement fait-il deux fois retour : des humains vers les non-humains en examinant les relations qu’ils tissent avec ces autres sortes d’êtres, et de l’anthropologue vers lui-même, et la conception de son approche disciplinaire, en l’amenant à façonner un autre genre d’outils conceptuels à partir des propriétés étranges et inattendues du monde vivant lui-même[16].
Montée au plateau. Entrée en forêt
Disons enfin ce qui explique notre montée au plateau.
Revenons à 2016, lors de la décade de Cerisy intitulée « Vers une république des biens communs ?[17] », placée sous la direction de Nicole Alix, Jean-Louis Bancel, Benjamin Coriat et Frédéric Sultan, quand Sarah Vanuxem nous fit entrer en profondeur, à la fois dans la réalité de pratiques oubliées de nos campagnes, et les sous-bois de notre Code civil.
En dressant une contre-histoire, ou même une lecture contre-jurisprudentielle du droit, où soudain le dogme de l’absolutisme propriétaire (usus, fructus, abusus) s’effritait au profit d’une lecture partageuse, relationnelle – là encore, relative, sinon relativiste de la propriété.
En montrant comment ce droit régissant la propriété, s’il nous est parvenu sous une acception dissymétrique faisant grand cas de cette lecture première, ménage encore dans ses plis les traces d’un droit du commun. « Il s’agit en cela d’exhumer des pratiques qui ont continué à exister par devers et dans le droit – comme le disait joliment Lionel Maurel ».
Sarah aura fait cette démonstration en allant enquêter sur des sections de communes de l’Ardéchois, mais aussi sur le plateau de Millevaches. Elle a bien voulu accepter de nous rejoindre ici, pour revenir sur ce dernier cas – et nous en sommes ravis.
En faisant venir à jour ces conceptions alternatives, elle propose une redéfinition du droit de propriété comme droit, non de posséder un bien, mais d’habiter un lieu. Ou plutôt un droit qui reviendrait au lieu lui-même de nous accueillir. Ainsi s’agirait-il moins d’attribuer la propriété à telle personne – que de reconnaître au sol/à la terre, destinés à durer davantage que nous ne le saurions, ses propriétés/facultés à nous recevoir
Tout au long de l’aventure Polygonale, nous étions en ville – à Bordeaux (à deux reprises), Nantes, Lausanne, Rennes, Lille, Anvers, Bruxelles, Paris. Nous glissions vers le commun : Marseille, Grenoble, St Etienne. Toujours engagés dans ce cycle nous sommes maintenant à la campagne, à Nedde, sur le plateau de Millevaches. En forêt. Mais dans une relation en réalité toujours étroite à l’architecture, et par là à la ville.
Nous avons commencé cette Polygonale par la visite de la scierie coopérative Ambiance bois. Nous allons visionner ce Temps des forêts. Nous avons pris connaissance de l’étonnant « Rapport sur l’état de nos forêts » émanant d’un collectif anonyme de citoyens mobilisés sur des enjeux écopolitiques, et de la réplique du Ministère de l’agriculture sous forme d’un Plan de communication, ainsi que de ses suites[18]. Ce Millevaches où – sur l’arrière-plan des rémanences du commun – s’affrontent militants d’une foresterie raisonnée et partisans d’une sylviculture industrielle, se présente à nos yeux d’évidence comme site de travail.
Nous n’avions pas anticipé le spectaculaire incendie de la « forêt » de Notre-Dame de Paris (15/04/2019). Ce drame patrimonial permet d’aiguillonner l’urgence de reconsidérer entièrement aussi – pour nous architectes – les tenants et aboutissants de la filière bois à laquelle on nous enjoint de croire. Constitue-t-elle la panacée du bien construire ?
Nous vous convions à entrer en forêt en emboîtant les pas de Hans Kreusler. Nous tenons là un très précieux guide qui nous permettra de comprendre l’entrelacement d’enjeux éthiques et des modèles économiques qui leur sont sous-jacents. Derrière lui, se dit aussi ce fil culturel, germanique par deux fois: un science et une conscience de la puissance de la forêt, où se profile l’arrière-plan du romantisme allemand – Neckar, Rhénanie, le Wallala, la peinture de Friedrich, et les savoirs jardiniers et paysagers qui lui sont subséquents ; et une pratique tant hédoniste que combattive de l’écologie : communs des lacs, forêts et friches berlinoises, « guerres aéroportuaires », luttes anti-nucléaires (AtomKraft Nein Danke), politique des Grünen, etc.
Nous tenons là un homme au savoir précieux, un « technicien forestier » – j’aime la modestie de cette qualification. Derrière ce rôle de « mainteneur » de nos forêts (à l’instar d’une maintenance bâtiment), se joue une position de puissance, et non de pouvoir, qui apparaît stratégique pour agir nos communs.
Emmanuel Doutriaux, le 24 mai 2019
[1] Violeau Jean-Louis, L’utopie et la ville, après la crise, épisodiquement, Paris, Sens &Tonka, 2013, p. 39
[2] Dardot Pierre et Laval Christian, Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014
[3] Ainsi en est-il des principes énoncés par Elinor Ostrom (Governing the commons, Cambridge univ. press, 1990) pour identifier les conditions nécessaires sinon suffisantes de formation des communs, et de leur translation dans l’identification faite par Coriat des communs informationnels (Coriat Benjamin, dir., Le retour des communs, la crise de l’idéologie propriétaire, Les liens qui libèrent, 2015.
[4] Voir à ce sujet la captation vidéo de son intervention au colloque « Vers une république des biens communs » à Cerisy: « Digital labor: conflits et communs à l’heure des plateformes numériques » (09/09/2016).
https://www.colloque-tv.com/colloques/vers-une-republique-des-biens-communs/digital-labor-conflits-et-communs-à-lheure-des-plateformes-numériques
[5] Dujarier Marie-Anne: “The activity of the consumer: strengthening, transforming or contesting capitalism?”, American Quartely. Special Issue, 2015.
[6] Ibid. L’invention du syntagme « communauté biotique » revient à Aldo Leopold. In : L’éthique de la terre, Paris, Payot & Rivages, 2019 (ed. orig. 1933-39-47).
[7] Ainsi de l’échange entre Lionel Maurel et le philosophe Alexandre Monnin à l’Université du bien commun, le 18/05/2019. Blog : https://scinfolex.com/author/calimaq/
[8] Le temps des forêts, film de François-Xavier Drouet, sorti en 2018, a été projeté en soirée lors de ces journées d’échanges, en présence du réalisateur. Ce documentaire prend la forme d’une enquête comparative fouillée entre les modèles économiques de la sylviculture industrielle – dont le plateau de Millevaches est massivement le champ d’application – et d’une foresterie raisonnée articulée sur des communs en réseau (collectifs citoyens de gestion partagée des forêts, scieries coopératives, filières bois en circuits courts, etc.).
[9] « Capra et Mattéi se réfèrent à la notion de propriété générative [qu’on peut] opposer à propriété extractive. Génératif définit de manière transversale une capacité de faire naître, faire émerger, engendrer, distinguer d’une reproduction du même par le même ou d’une fabrication dont un agent intentionnel serait responsable. Le terme rejoint le sens ancien de phusis – la nature comme ayant le pouvoir de croître et de s’épanouir. Mais les sciences contemporaines associent plutôt générativité et couplage dynamique entre processus faisant émerger des propriétés nouvelles irréductibles à celles des processus qui y participent. » in Serge Gutwirth, Isabelle Stengers, « Le droit à l’épreuve de la résurgence des communs », https://works.bepress.com/serge_gutwirth/119/
[10] Voir à ce sujet Zask Joëlle, La démocratie aux champs, Paris, La découverte, 2016
[11] Pour faire allusion au titre de l’ouvrage de Cyrille Weiner, Christophe Laurens, Jade Lindgaard et Patrick Bouchain : Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre, Loco, 2018.
[12] Milieu animal et milieu humain, Paris, Payot et Rivages, 2010 (1ère édition en langue française : 1965 ; édité en langue allemande en 1934, sous le titre : Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen – Bedeutungslehre).
[13] Watsuji Tetsurô, Fûdo, le milieu humain (préface et traduction : A. Berque), Paris, Cnrs éditions, 2011 (ed. orig.1935).
[14] Simondon Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1958 (réed 1989)
[15] Leur procès en anthropocentrisme a par la suite été assez efficacement mené par Florence Burgat, in Qu’est-ce qu’une plante ? Essai sur la vie végétale, Paris, Seuil, 2020.
[16] D’autres auteurs encore se signalent dans cette veine d’un décentrement objectif, pour leurs travaux portant cette fois sur la relation à l’animalité, dont ceux des philosophes Dona Haraway (Manifeste des espèces compagnes, 2003-10), Baptiste Morizot (Sur la piste animale, 2018) ou Vinciane Despret (Habiter en oiseau, 2019).
[17] Voir l’enregistrement vidéo de cette http://www.ccic-cerisy.asso.fr/bienscommuns16.html et Vanuxem Sarah, La propriété de la terre, Marseille, Wildproject, 2018
[18] « Rapport sur l’état de nos forêts et de leurs devenirs possibles », par des habitants du plateau de Millevaches, novembre 2013. « Plan de communication pour le secteur de la forêt et du bois », par Eric Bardon et Charles Dereix, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, novembre 2017. « Comprendre les influences sociétales, la filière forêt & bois », note de tendance Comfluence, 18/02/2019.