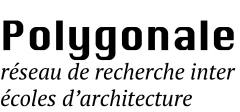Quatre axes de questionnements auront en premier lieu marqué notre approche à distance du « terrain dunkerquois », alors que nous étions frappés par le premier épisode de la pandémie[1]. Politique de la gratuité (dont l’exceptionnelle généralisation des transports en libre-accès), partage de la connaissance, design participatif, politique de l’hospitalité – auront formé une convergence heuristique pour réfléchir et imaginer l’affaire du commun qui travaille le cycle en cours de nos Polygonales. Sans que ces orientations ne se confondent exactement avec cette problématique, mais qu’elles la précèdent, la suivent, la contredisent et la recouvrent en partie.
Considérons-les donc, l’une après l’autre.
Gratuité
« La gratuité ce n’est pas le produit débarrassé du coût mais débarrassé du prix : [Il s’agit d’une] gratuité économiquement construite. [Ainsi] l’école publique est gratuite, mais a un coût (payée par nos impôts), et elle est culturellement et politiquement construite. »
Ce sont là les mots de Paul Ariès, politologue engagé dans la revitalisation de cette gratuité[2]. Il voit trois règles à faire valoir en la matière. La première tiendrait à la non-limitation de la gratuité à une sphère particulière de biens et services : pas d’exclusivité du domaine marchand « qui enfermerait la gratuité dans le seul registre du vital ». La seconde tend au contraire à cantonner la gratuité à ce qui siérait à une bonne politique : pas de mésusage de la ressource commune qui soit compatible avec un libre accès. La troisième consiste à faire de la gratuité l’instrument premier d’une reconsidération plus large de la notion de service public.
Soit donc cette amorce à Dunkerque, au titre d’une politique communale audacieuse, qui se matérialise, entre autres actions originales, par son offre de transports en commun gratuits. Est-ce à dire que « la gratuité est comme un fait culturel presque naturel dans le Nord » – comme l’avance Vanessa Delevoye, promotrice d’un projet qui aura incarné la mutation fonctionnelle et symbolique du territoire urbain avec l’arrivée de Patrick Vergriete à la Mairie ?
Sans dénier la réussite apparente de cette politique publique (les pratiques de la mobilité ont considérablement évolué depuis 2018, et le territoire de l’agglomération s’est en quelque « rouvert » à des pans entiers de la population locale – Julie Calnibalosky en attestera dans sa présentation), il nous importe de relever que le commun ne se confond pas nécessairement avec le gratuit. Ainsi par exemple le modèle économique de l’économie sociale et solidaire est-il non lucratif, sans être non-marchand. Il n’est pas certain non plus que le commun s’identifie avec le domaine public, pour renvoyer à une catégorisation juridique de l’urbain (ou à l’espace public, pour dire sa qualification politico-architecturale). Car la soumission de ce dernier aux Pouvoirs publics – quelle que soit leur échelle – lui ôte souvent sa capacité à exister, en lui déniant sa capacité à l’appropriation. La controverse Hidalgo et l’affaire Finkielkraut place de la République durant Nuit Debout ont dit tant cette difficile compatibilité que l’illégitimité relative d’une occupation régie sur le mode de l’exclusivité[3].
Connaissance
« Le commun informationnel désigne [des] biens non rivaux et (généralement) non exclusifs [qui ne souffre pas d’avoir à être partagés – ici nulle « tragédie des communs », due à une surconsommation, n’est à craindre]. [Pour autant ils] ont été rendus nécessaires par une « exclusivité » artificiellement construite par des droits de propriété spécifiques (…) dits de propriété intellectuelle [associant à des biens par essence non rivaux des droits exclusifs]. »
Coriat Benjamin, in Le retour des communs, op.cit., p 40-41
On sait cette nouvelle menace dont la libre jouissance de l’information et de la connaissance fait l’objet de la part des promoteurs du droit de propriété intellectuelle, dont la politique des brevets est le bras armé le plus redoutable. Le mouvement des creative commons est l’expression d’une résistance acharnée à cette seconde enclosure. De fait, la gouvernance des communs informationnels est orientée, non sur la conservation des ressources, mais sur leur enrichissement et leur multiplication. Et leur non-exclusivité est cette fois sans conteste le signe de leur vitalité.
Il y a dans les réflexions et actions menées à l’endroit de la production de l’art et du savoir, et de leur promotion et diffusion, quelque chose de tout à fait exceptionnel à Dunkerque du fait de la qualité des équipes et des équipements réalisés depuis peu. Tels, le réseau des balises et la bibliothèque centrale, dont la conception formée sur un récit des usages en amont de toute considération formelle, et une attention accordée aux actions usagères, dans la diversité des prises, échanges, appropriations possibles, en deçà de l’acte de « consommation » livresque – porte à réfléchir. Dans une moindre mesure la réalisation d’un learning center urbain (halle aux sucres) incarne l’importance accordée ici à la nouvelle économie de la connaissance – fût-ce ici un plan essentiellement symbolique (segmentation fonctionnelle et localisation excentrée de la Halle aux sucres limitent la portée de l’expérience). Tandis que l’exceptionnelle aventure tant programmatique qu’architecturale du Frac Grand Large témoigne par l’importance accordée à la place du public (accessibilité physique, mise en jeu des déplacements ; politique de médiation et formation à la création ; programmation en prise sur la culture populaire), d’une entreprise de démocratisation culturelle.
« Le public s’oppose au privé – nous disent Dardot et Laval – comme le commun s’oppose au propre. Si d’un côté il s’oppose donc à tout ce qui relève du domaine privé, mais n’est pas nécessairement relié à l’État [par exemple, la lecture publique], (…) d’un autre côté le terme ‘public’ désigne ce qui tient à l’État en tant que tel, à ses institutions et ses fonctions [ainsi en va-t-il de la fonction publique].[4] »
Pour autant, il est clair, cette fois encore, que public et commun ne sauraient se confondre, tant demeure une différence irréductible à établir entre le premier, au sens qu’il recouvre dans la question des services publics, et le second, au sens de la proactivité de projets du commun (à la différence du donné des biens communs naturels) – dont l’action peut le cas échéant s’encastrer dans la délivrance universelle d’un service, sans s’y réduire pour autant. Disant cela, on peut avoir à l’esprit le travail de Lionel Maurel, à l’Institut National des Sciences Humaines et Sociales du Cnrs, où son travail, centré sur les questions de science ouverte, de publications scientifiques et des données de recherche, consiste par exemple, en tant que commoneur acharné qu’il est, à s’assurer depuis l’intérieur de l’institution, que la recherche financée avec les deniers publics, soit libre d’accès sur internet.
Participation
« Le projet En Rue s’inscrit radicalement dans cette politique du faire puisque c’est en « faisant avant », mais aussi en « faisant avec », en « faisant différemment » qu’un rapport critique s’éprouve et se développe en direction des programmes de rénovation urbaine. (…) Pour reprendre les propos de Tim Ingold, qu’est-ce que « Faire l’En rue » nous apprend à faire ? Dès cette première phase de chantier, nous avons pu observer que des méthodes, des connaissances, des savoirs se sont développés à travers cette expérience collective (…) En tant que chercheurs nous avons eu l’idée, l’envie de venir documenter ces pratiques. (…) Le fait que notre « faire avant » soit placé suffisamment en amont du projet ANRU nous ouvre plusieurs années d’expérimentation et, par là-même, nous permet de gérer différemment les questions de temps et de rythmes ; (…) Changer les rythmes dans la production c’est déjà̀ changer la production, changer les rythmes dans la ville aussi.»
Louis Staritzky, http://fabriquesdesociologie.net/EnRue/author/louis/ _ consulté le 20/05/2021
« L’espace public n’est pas uniquement un espace de paroles, un espace de prises de parole, il est aussi un espace d’expériences partagées. « Gester » avec autrui, en sa présence et en interaction avec lui, le faire en quittant son chez-soi et en se risquant dans une relation à l’autre est un enjeu marquant d’une vie de quartier car il est source de coopération et d’apprentissage partagé. « Gester » ensemble (…), le faire dans l’espace public, peupler cet espace avec la vie (des gestes et des activités) contribuent à ce qu’un quartier se fabrique (un peu plus) en commun.»[2]
Pascal Nicolas-Le Strat, in http://fabriquesdesociologie.net/EnRue/2018/07/02/lespace-public-en-gestes-et-en-paroles/_ consulté le 20/05/2021
Il y va d’un trait de génie d’avoir su nommer ce qui vient de la rue, des têtes et des bras incarnés (En Rue), dans l’attente/expectative de ce qui viendra des administrations lointaines (l’Anru) et de son instrumentation lourde.
Tout contre en effet cet En Rue, tant au sens d’une indéniable op-position (comment accepter le peu de considération que cette Agence nationale de rénovation urbaine accorde aux habitants dont elle bouscule l’existence ?), tant au sens d’une pré-position de l’action frugale, sinon pauvre (réconforter les communs extérieurs, en mobilisant l’action habitante) à l’endroit, à l’envers, de l’action dispendieuse et massive d’une confortation technique et sociale qui ne serait pas dénuée de fondements, si ses modes opératoires et ses formes applicatives (au titre desquelles la démolition pure et simple) ne l’étaient bien davantage.
Avec l’En Rue dans ces Grands ensembles de Saint-Pol, Teteghem ou ailleurs, nous aurons essayé d’accomplir ces aller-et-retours entre théorie sensible (appuyée tout de même sur un bataillon d’experts) et fabrication concrète, de saisir sa position du dialogue, par le recours à des expérimentations sur des territoires. « Ce droit de faire – comme le dit Patrick Le Bellec – qui questionne les institutions dans leurs fonctionnements, [l’objectif n’étant autre de passer] de la formation (subie) au faire, ou à la fabrication active. »
Pour autant ces expériences – des analyses de fond en témoignent[5] – sont par nature imparfaites, coincées qu’elles demeurent entre autonomie associative et nécessaire reconnaissance institutionnelle, et entre le temps court de l’action et la durée de sa gestion à long terme. Ce qui dit la difficulté pour les habitants de la réelle prise en charge d’une telle entreprise, qui est indéniablement médiée à l’origine, leur est en cela quelque peu étrangère sans doute, ou finit par inquiéter les édiles si la mobilisation devenant forte, la participation s’enclenchant complètement, l’émancipation devient à leurs yeux extrême. L’expérience du Cube – un local octroyé en bail précaire à l’association (un « contrat de commodat »), et qu’elle aura progressivement « surinvesti » – aura dit cette difficulté de la bonne distance à maintenir entre associatif et institutionnel, et de la bonne côte à garder entre installation légère des mobiliers urbains qui sont la marque de fabrique de la structure, et occupation lourde d’un immeuble, par un acteur cherchant soudainement à stabiliser son emprise.
Hospitalité ou hostilité?
« L’an dernier, je me rappelle un mauvais jour : j’avais eu comme le souffle coupé, un haut le cœur en vérité, quand j’ai entendu pour la première fois, la comprenant à peine, l’expression « délit d’hospitalité ». En fait, je ne suis pas sûr de l’avoir entendue, car je me demande si quelqu’un a jamais pu la prononcer et la prendre dans sa bouche, cette expression venimeuse, non, je ne l’ai pas entendue, et je peux à peine la répéter, je l’ai lue sans voix, dans un texte officiel. Il s’agissait d’une loi permettant de poursuivre, voire d’emprisonner, ceux qui hébergent et aident des étrangers en situation jugée illégale. Ce « délit d’hospitalité » (je me demande encore qui a pu oser associer ces mots) est passible d’emprisonnement. Que devient un pays, on se le demande, que devient une culture, que devient une langue quand on peut y parler de « délit d’hospitalité », quand l’hospitalité peut devenir, aux yeux de la loi et de ses représentants, un crime ? (…) Il faut que nous puissions retrouver le goût d’habiter une culture, une langue et un pays où l’hospitalité enfin ne soit plus un crime, dont la représentation nationale ne propose plus de punir l’accueil de l’étranger et où personne n’ose parler encore de « délit d’hospitalité ».
« Quand j’ai entendu l’expression “délit d’hospitalité … – GISTI _ 21 mars 2014 — Au cours de cette soirée, Jacques Derrida improvisait l’intervention qu’il a transcrite ensuite pour la revue Plein Droit.
À Dunkerque se sont affrontés et s’affrontent encore deux principes inscrits dans notre arsenal juridique, qui fixent deux conceptions antagonistes de la relation à autrui, celui de « l’assistance à personne en danger » et celui de ce funeste « délit de solidarité ». Cette controverse instruit ce que fut et ce qu’est devenue la « politique d’accueil » des migrants à Grande-Synthe – dans ce camp de la Linière où un maire prit seul l’initiative de l’hospitalité, en forçant in fine la main du pouvoir régalien, le conduisant à prendre en charge le minimum des conditions sanitaires requises pour ce faire.
Et ce que demeure dans la Région, à Calais en particulier, ce nœud gordien entremêlant indigence des populations réfugiées, pauvreté des populations locales et indignité des conduites politiques nationales et internationales.
Or des actions citoyennes et des collectifs d’architectes (dont le collectif Perou et Cyrille Hanappe) nous auront appris à considérer le potentiel de ces situations, de la présence de ces populations allogènes sur le sol local – en engageant d’autres formes de recherche-action, cette fois sur le thème de la ville accueillante. « La logique [consisterait à cette occasion de] penser [en d’autres termes] la ville en commun », en s’emparant de ces origines et compétences nouvelles pour faire d’un camp précaire l’occasion d’un quartier nouveau. Il s’agit en somme de « considérer tout cet ensemble qui fait l’humanité de cette situation ».
Inutile de dire, là encore, que ces initiatives auront eu à faire face aux décalages entre agendas individuels, associatifs et citoyens (traitant de l’urgence au quotidien) et agendas institutionnels ou politiques (collectivités territoriales et locales, État), dont le calendrier fonctionne à l’inertie tant leur action oscille entre considérations policières et préoccupations sanitaires quand l’opinion publique en vient à s’émouvoir trop fortement. De fait cette politique de l’hospitalité fonctionne ici comme ailleurs sous le motif d’une chronique à éclipses, dans les temps noirs desquelles grincent les réflexes d’hostilité.
Ce qui nous a menés à Dunkerque
Cette entrée en matière pour dire, donc, ce qui nous a menés à Dunkerque, ce commun qui nous attire et glisse entre les doigts sitôt que nous l’approchons. En somme, par les deux tenseurs que sont l’action publique et les mobilisations citoyennes, des choses s’y jouent qui renouvellent le sens du domaine public – en réhabilitant la qualité du service public et assumant sa gratuité – et réactualisent le commun – en son fondement historique, distinguant les droits d’usage de commoneurs d’une propriété revenant à un tiers. En des plans de souveraineté et d’usages territoriaux superposés procédant de logiques souvent complémentaires, ces expériences ouvrent un champ d’exploration inédit pour l’expérience sensible de la ville.
Cette totalité foisonnante, qui est non unitaire – ce qui est fort heureux –, par ces actions publiques et initiatives citoyennes concurrentes, donne quelques gages d’optimisme. Aussi aurons-nous « reçu » pour cette entrée en matière celles et ceux qui dessinent à Dunkerque un réseau incroyablement actif, dont, à l’avoir éprouvé au long de ces journées, on ressent la capacité à reconnaître compétences et attributions d’autrui, ce qui a un effet déclencheur pour les initiatives ponctuelles conjointes.
Anne Rivollet, tout d’abord, directrice du site de Dunkerque de l’Eså NPdC (École supérieure d’art Nord-Pas de Calais), qui aura accueilli Polygonale15 pour l’ensemble des sessions « autour de la table » de ces trois journées.
Keren Detton, directrice du Frac Hauts de France, qui nous aura accueillis aussi en ses lieux pour la visite du Frac Grand Large.
Patrick Le Bellec, qui est tant chargé de mission à la Direction de la culture de la Ville de Dunkerque, qu’acteur de l’En Rue, et qui aura nous accompagnés tout au long de ces journées et sur le terrain de ses actions.
A tous trois nous aurons demandé de répondre à ces questions : Qu’est Dunkerque selon vous ? Quel est votre projet (à Dunkerque, dans la ou les institutions qui sont les vôtres) ? Comment nous voyez-vous (ou que comprenez-vous de notre projet, de notre programme, de notre venue à Dunkerque) ?
Julie Calnibalosky, chargée d’études pour l’association de chercheurs Vigs et animatrice de l’Observatoire des villes du transport gratuit, en résidence à l’Agur (Agence d’urbanisme Flandre-Dunkerque), aura aussi été des nôtres pour faire état de l’étude quelle a réalisée sur les effets de la gratuité des transports collectifs sur les représentations symboliques et les comportements de mobilité des jeunes Dunkerquois.
Amaël Dumoulin, directrice de la Bibliothèque centrale de Dunkerque, n’aura pas pu être des nôtres lors de cette séquence de « dires d’acteurs », mais elle nous aura accordé le privilège de nous accueillir un dimanche en tout début de matinée pour une passionnante visite de son établissement.
[1] Cette première enquête a été entreprise au sein du séminaire Constellations_Architectures du commun (dir. Emmanuel Doutriaux et Carolina Menezes-Ferreira), à l’Ensa Paris Val de Seine, au printemps 2020.
[2] Paul Ariès : « Vers une civilisation de la gratuité », in https://www.urbislemag.fr/-la-gratuite-c-est-miser-sur-l-intelligence-collective–billet-573-urbis-le-mag.html – consulté le 20/04/2020. Ariès dirige depuis 2006 l’Observatoire international de la gratuité des services publics et des biens communs (OIG). On peut citer parmi ses nombreux ouvrages : Gratuité vs capitalisme, Éditions Larousse, 2018.
[3] Certes, certains juristes spécialistes des communs, telle Séverine Dusollier (« Pour un régime positif du domaine public », in Coriat Benjamin dir., Le retour des communs, la crise de l’idéologie propriétaire, Les liens qui libèrent, 2015, p 244), plaident pour une habilitation de la notion de commons ou de res communs au sein du domaine public, selon les motifs d’une absence de propriété et une communauté de l’usage, en y voyant le sceau d’une inclusivité dont il s’agirait de souligner la positivité et de la consolider juridiquement. Reste que le périmètre extensif de cette chose commune et son assujettissement à l’autorité politique en ayant la charge ne laisse pas d’en demeurer songeur. Le premier des principes édictés par Elinor Ostrom n’est-il de désigner un périmètre, au propre comme au figuré, à la communauté concernée par une ressource ? Penser une relation d’emboîtement et de complémentarité entre milieux du communs et sphère publique ne comprendrait-il l’avantage d’éviter le mélange des genres ?
[4] Dardot Pierre et Laval Christian, Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014, p 28
[5] Ainsi du mémoire de Léa Villain, « En Rue vs Anru. Faire la rénovation urbaine en commun », séminaire Constellations_Architectures du commun (dir. E Doutriaux & C Menezes-Ferreira), Ensa Paris Val de Seine, 2021