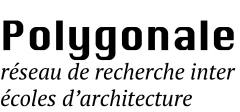Cet entretien avec Patrick Le Bellec, en charge de la mission Art et espace public à la Ville de Dunkerque, et co-fondateur du collectif En Rue, a été réalisé par Léa Villain pour son mémoire de master en école d’architecture[1] : « En Rue vs Anru, Faire la rénovation urbaine en commun ».
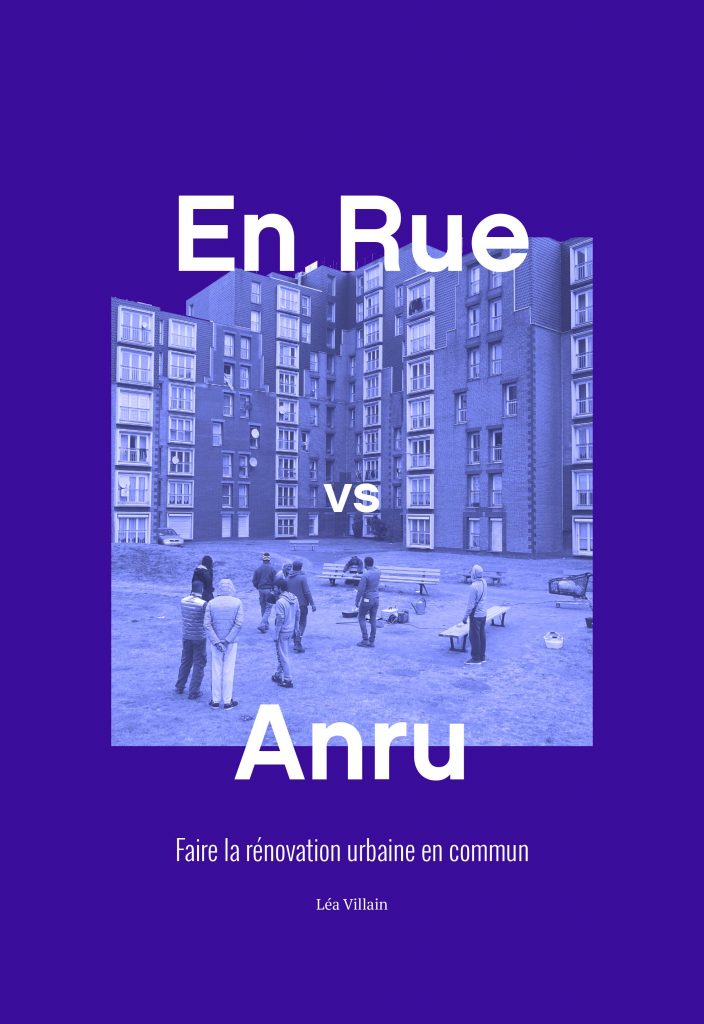
Entretien du 21 avril 2020
Léa Villain : Tout d’abord, merci d’avoir accepté cet entretien. Comme je vous l’ai expliqué dans mon mail, ma camarade Rawane Bensellam et moi, travaillons sur le sujet du design participatif à Dunkerque. Nous nous sommes notamment intéressées au projet En Rue, que vous avez co-fondé avec Nabyl Karimi dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers Guymener et Jean Bart dans l’agglomération de Dunkerque.
Patrick Le Bellec : Oui… Enfin l’approche ne tient pas seulement à deux personnes, mais concerne plus de monde que ça.
L.V. : Oui, justement la question que j’allais poser, c’est comment finalement est venue l’idée de créer ce collectif ?
P.L.B. : Pour que ce soit clair au démarrage, je travaille pour la ville de Dunkerque à la Direction de la culture, sur une mission particulière Art et Espace Public, depuis 2008, sur un premier programme qui s’appelle « Opener ». Dès le départ de cette mission on posait les enjeux de l’appropriation par ceux qui y vivent, des contextes urbains. Nous avons notamment fait un projet qui s’appellait « Jardins barges », qui a duré un peu plus de cinq ans. Nous avons ainsi inscrit des projets dans la durée, dans une forme de permanence. Ça c’est important, parce qu’on peut faire de l’évènementiel, mais cela se fait à l’intérieur d’un projet long.
L.V. : Oui car en effet, les projets de rénovation urbaine sont finalement des processus qui s’inscrivent dans un temps long.
P.L.B. : Le programme « Opener » ne travaillait pas dans le contexte de rénovation urbaine, mais plutôt à partir de délaissés urbains. Suite à la première phase de cette première mission, j’ai rencontré un certain nombre de personnes, dont la responsable de la politique de la ville Christine Decodts, à Saint-Pol-sur-Mer. Ça m’intéressait d’autant plus qu’un programme de rénovation urbaine de l’Anru allait arriver à Saint-Pol ; ça m’intéressait de savoir dans quelle mesure nous pouvions construire quelque chose avec la politique de la ville. Voilà, c’est ça le démarrage : que ma mission se déplace de la commune de Dunkerque à la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer. Le contexte était assez stimulant, avec une ancienne cité de cheminots, qui est intéressante parce que c’est un modèle urbain de cités jardins, et puis ça jouxtait deux barres d’immeubles en souffrance urbaine datant des années 1970, assez typiques ici à Dunkerque. La place de l’action culturelle était peu développée dans ce cadre-là. C’était donc un terrain qui m’intéressait particulièrement. Par ailleurs, la particularité de cette démarche, c’est qu’on ne rédige pas de projet à l’avance pour les gens. Je viens dans ce territoire sans savoir ce que je vais y faire. Ça c’est important, et cela tient à des rencontres avec des personnes, notamment avec la cellule de prévention spécialisée, qui est logée dans un appartement en pied d’immeuble dans la barre, et qui est constituée de cinq éducateurs de rue. C’est avec eux que naît la possibilité du projet. Je ne les connaissais pas avant que Christine ne me les présente.
L.V. : Ce sont finalement ces éducateurs qui font le lien entre vous, les institutions et les habitants ?
P.L.B. : Oui, c’est ça. Je pense que dans le cadre d’une action culturelle comme ça, qui s’engage dans un contexte social précaire, l’acteur culturel doit y aller avec des partenaires qui connaissent bien les gens, les situations, les familles, les enfants, les parents… Et donc à partir du moment où l’on s’entend bien, j’invite en résidence un jeune journaliste de France Culture, qui a mené pendant deux ans un travail d’enquête, de rencontres, d’ateliers radios avec des jeunes de la prévention spécialisée, avec les éducateurs, les habitants… Le projet du collectif En Rue est né à l’issue de tout cela. Vous voyez, il y a deux ans d’enquête avant la naissance du collectif. Donc voilà, la confiance s’installe, et donne envie d’aller un peu plus loin. Le constat que nous avons fait durant ce temps, c’est que les espaces publics en pied d’immeuble étaient particulièrement abandonnés : 2000 habitants et aucun jeu pour enfant, c’est complètement étrange. Pas de lieux de convivialité dans les espaces publics qui sont assez beaux, assez grands. À partir de là, en rencontrant Catherine Rannou, que vous connaissez peut-être[1] – elle était alors en résidence au FRAC, je connaissais son travail à La Villette, ça m’intéressait de la rencontrer, et nous avons bien sympathisé – nous commençons à réfléchir à un projet, en se demandant comment les habitants pouvaient s’approprier les lieux par eux-mêmes, ces espaces publics délaissés en particulier. Nous sommes donc partis sur un protocole artistique, en réemployant du matériel urbain déclassé, du bois… En gros l’idée première était de faire un atelier de construction bois. Ensuite nous avons organisé une réunion avec le réseau des habitants que connaissent les éducateurs, et on fait de la cartographie collaborative. Cette réunion, ce sera la seule, et après on part en chantier. Depuis 2017, nous faisons à peu près cinquante jours de chantiers participatifs à Saint-Pol par saison, en associant le collectif d’architectes Aman Iwan. On construit donc des choses avec les habitants, à partir de leur diagnostic d’usage. Ce sont des mots très employés aujourd’hui, mais nous, nous sommes très concrets par rapport à cela ! On ne fait pas juste deux-trois balades, puis on s’en va !
L.V. : Ces ateliers sont-ils ouverts à tous ?
P.L.B. : Oui, ils sont ouverts à tous, on achète des machines, on nous en prête, on met des établis dehors le matin, et ils finissent à pas d’heure la nuit. Ils se tiennent sur 5-6 jours consécutifs, on occupe l’espace sous la forme d’un chantier mobile, on peut dire ça. Et voilà, cet atelier est ouvert à tous, aux enfants comme aux adultes. Il est à vue, en pied d’immeuble, là où c’est passant. Les enfants s’arrêtent, les parents discutent… Donc c’est aussi prétexte à discuter, à échanger, à parler de ce qu’est un espace public : à quoi ça sert ? pour qui ? Ça révèle des savoir-faire, ça c’est un deuxième axe. Quand on dit que dans ces quartiers, il n’y a pas de savoir-faire, c’est faux. Il y en a bien. Et il y a aussi des désirs d’apprendre.
Tout cela valorise le territoire, en se montant à partir de 2017, au moment où le programme [institutionnel] de rénovation urbaine n’est pas validé. Donc nous nous plaçons en amont de la rénovation urbaine. Et comme tout le monde parlait de l’Anru[2], le bailleur surtout (on s’entend très mal avec le bailleur, on ne collabore pas du tout avec lui), on s’est dit qu’on allait s’appeler le collectif « En Rue » : tout le monde attend l’Anru, donc faisons l’En Rue avant l’Anru. Voilà c’est un jeu de mots, on joue là-dessus, et on se dit « un jour l’En Rue rencontrera l’Anru ».
L.V. : Finalement, êtes-vous plutôt dans un rapport d’opposition avec l’Anru, ou bien essayez-vous au contraire de travailler avec elle ?
P.L.B. : Je pense qu’on développe une attitude critique, voilà. On repart du réel d’un territoire et on crée une forme de régularité, voire de permanence de l’action. Ce rapport-là, il construit pour nous une sorte de « tige de la connaissance » réciproque, entre des usages d’habitants, autour de questions comme : qu’est-ce qu’habiter là-bas ? qu’est-ce que cela veut dire de rénover ? On construit une sorte d’éducation populaire et à partir de là, on rentre dans un rapport critique sur la manière dont les « grosses machines institutionnelles » arrivent dans les quartiers. Donc ce n’est pas un rapport d’opposition stricte, mais cela tient d’une relation critique plutôt positive.
L.V. : Oui, votre but c’est peut-être plutôt d’être dans une critique qui soit constructive pour les institutions, et qui permette peut-être de bouger les choses dans leurs méthodes de rénovations urbaines, dites « participatives ». Nous avons lu dans les articles rédigés par les chercheurs en sciences sociales sur vos travaux[3] qu’ils préféraient parler de « démocratie éprouvée » inclusive, plutôt que de « démocratie participative » comme le font les institutions. Avez-vous d’ailleurs pu observer des changements dans leurs manières de faire à ce sujet ?
P.L.B. : Disons que le rapport aux institutions que l’on a nous de manière réelle, ce n’est pas directement avec l’Anru, c’est avec les services de la Communauté urbaine de Dunkerque [Cud], en charge de réaliser les programmes Anru sur les différents territoires de l’agglomération. Donc les interlocuteurs, ce sont eux principalement, le Npnru [Nouveau programme national de renouvellement urbain[4]] et la Cud, la politique de la ville au local et à la communauté urbaine. On travaille aussi avec les services liés aux espaces naturels, aux paysages, aux études de dépollution… L’enjeu critique qui est assez vaste, consiste à revendiquer une nouvelle gouvernance dans un programme de rénovation urbaine, à tenir un peu plus compte des habitants, à les associer à la décision. Mais bon cela, autant vous dire que ce n’est pas gagné ! Mais on a essayé des choses, c’est-à-dire que quand on a des réunions avec des institutions, je ne suis pas seul à y aller avec Nabyl, on y va avec des habitants. Et ne serait-ce que ça, ça interroge et ça peut déranger, parce que la méthodologie qu’ils appliquent n’associe pas les habitants en amont de la décision. Pour nous ce n’est pas recevable et ça peut créer des tensions, et donc à des moments on ne se parle plus, et après on revient… Et cela agit un projet qu’on souhaite être un collectif informel, je dirais.
L.V. : Un projet militant aussi ?
P.L.B. : Oui, oui, militant ! On pense que l’action sociale, l’architecture, l’action culturelle peuvent avoir un rôle politique à jouer. Donc là-dessus nous étions bien accompagnés par la politique de la ville de Saint-Pol, qui n’existe pas sans mal, car eux aussi à Saint-Po font le grand écart entre la machine ANRU et la réalité du programme de rénovation urbaine. Sur ce terrain particulier il y avait une association, « dormante », anciennement montée par Farid, un des éducateurs, que nous avons réactivée. Donc nous avons disposé d’une structure associative, de loi 1901, qui tient lieu de support des actions du collectif et qui nous permet de chercher des financements indépendants.
L.V. : Mais votre structure juridique est bien celle de « collectif » ?
P.L.B. : Oui, En Rue n’est pas en « asso », mais il existe une association d’habitants qui accompagne les projets du collectif. Si on distingue les choses, l’association peut accomplir d’autres missions, pour autant elle nous a finalement permis d’obtenir des financements indépendants, c’est surtout ça qui est important.
L.V. : Et donc, si ce n’est pas trop indiscret, nous aurions aimé savoir où justement vous trouviez ces financements ? Nous avons pu voir la mise en place de « fiches-actions » qui vous permet de recueillir des subventions des bailleurs, de l’Anru, de la commune. Avez-vous mis en place d’autres moyens pour obtenir des financements ?
P.L.B. : En 2017, quand on a démarré, on n’avait vraiment pas grand-chose. Moi j’ai un budget de 10 000 euros par an sur ma mission, par la ville de Dunkerque. Et puis on a été dès la première année, et ce pendant trois ans, accompagnés par le Learning Center de Dunkerque. Ceux-ci ont rémunéré directement l’équipe d’architectes Aman Iwan, et nous ont acheté un peu de bois aussi. L’année 2017 a aussi été consacrée à monter les dossiers de demandes de subventions. Nous sommes maintenant accompagnés par la Région au titre de la politique de la ville de Téteghem. Dès le départ nous avons aussi été aidés par la Fondation de France. Et puis en 2018, on a accepté – attention ! – de recevoir de l’argent de Vinci ! Mais nous avons là un argument : un garçon du quartier, Mohammed, travaille pour Eurosia, et donc le groupe Vinci. C’est par cet intermédiaire que nous avons reçu cette aide. Nous avons aussi rencontré sur un axe art/citoyenneté la fondation Carasso, qui est devenu notre principal financeur. Et ça, ça change la donne, car une fondation familiale qui soutient notre projet, aux yeux des institutions, ça a son poids. On est passé d’un budget de 30 000 euros par an, à 100 000 euros. Et aussi on a créé de l’emploi, ça aussi c’est important. Trois emplois au total ont été créés au sein de l’association.
L.V. : Il s’agit d’habitants du quartier ?
P.L.B. : Oui c’est ça. Il y a deux habitants qui ont un contrat d’adulte-relais, donc ça correspond presque à un 30 heures/semaine, il y a un coordinateur pour l’association Eco-chalet, et puis deux emplois à 10 heures par semaine, donc au total ça fait trois emplois à temps plein. Ces enjeux qu’on avait aussi posés dans les quartiers, qui sont posés par ailleurs par l’Anru, consistent à savoir comment engager une action sociale dans des quartiers avec des statistiques de taux de chômages, des jeunes notamment, très élevés. C’était un enjeu pour nous que l’action puisse créer un emploi, et permette une réinsertion, une reconnaissance. On a donc un comité de pilotage qui associe Pôle Emploi avec différentes personnes.
L.V. : Par ailleurs, nous avons appris par nos lectures que l’équipe de chercheurs en sciences sociales n’est arrivée sur le projet qu’un an seulement après son début, lorsque vous faites la connaissance de Pascal Nicolas-le Strat à la Halle aux sucres. Comment a été prise la décision de leur participation. Était-ce un souhait du collectif, ou bien une demande la ville ? Quel rôle jouent-ils dans le processus de rénovation urbaine ? Qu’est-ce que leur arrivée a changé pour le projet ?
P.L.B. : Je connaissais le travail de Nicolas-Le Strat depuis longtemps. Sur la première mission nous n’avions pas forcément eu le temps, ni les moyens, mais voilà ça s’est fait comme ça, sur l’opportunité d’une rencontre. Pour lui, cela correspondait aussi à une période dans son travail de chercheur, qui souhaitait retrouver du terrain. Donc voilà ça se passe très bien depuis lors, et je suis très content que Pascal, Louis et Martine nous accompagnent dans cette démarche, parce qu’il y a nécessité sur ces projets au long cours d’être accompagné par des chercheurs, notamment des sociologues, c’est très important.
L.V. : Est-ce que leur présence est nécessaire notamment pour tenter de traduire ce qu’il se passe dans le collectif, afin de le communiquer, aux personnes extérieures, aux institutions ?
P.L.B. : Ça peut avoir cette résonnance-là, mais l’intérêt c’est surtout de tenir un « journal de bord » de ce qui se passe. Quand on fait l’action, on n’a pas le temps d’écrire sur l’action, c’est compliqué. Moi je coordonne, Nabyl aussi. Et donc c’était très important d’avoir ce journal de recherche qu’est le blog, pour mettre des mots sur ce qu’on est en train de faire. Quand Pascal parle de « démocratie éprouvée » bah voilà, ça nous fait réfléchir tous sur ce qu’on est en train de faire, parce qu’on est un peu aveuglés par l’action, je pense. Cela aide aussi à faire comprendre à la Communauté urbaine, qu’elle n’associe pas assez de recherche en sociologie sur la fabrication des territoires, et de manière plus générale qu’il n’y a pas assez de recherche-action au sein des institutions.
L.V. : Donc, si je comprends bien, cette volonté d’intégrer une équipe de chercheurs au projet, provenait de vous, du collectif, et non de la ville.
P.L.B. : Oui, voilà. Malheureusement, il y a comme un impensé autour de cette question du « qu’est-ce qu’on est en train de fabriquer comme nouvelle culture ? ». On n’est pas assez accompagnés. Il n’y a pas assez de budget… On peut faire intervenir des gens pour une étude mais pas une permanence de recherche, alors que nous, on s’inscrit dans l’idée de la durée.
L.V. : Et justement, pour vous, cette notion de permanence de recherche elle est déterminante dans le cadre d’une rénovation urbaine ?
PLB : Oui, c’est indispensable. Le temps de la rénovation, on le sait, est long. Le temps des habitants, ce n’est pas celui des politiques. Ces temporalités-là, il faut les travailler, il faut se les coltiner, il faut travailler avec.
L.V. : Finalement, tout cela se rapproche du travail qu’ont pu mener Patrick Bouchain et Sophie Ricard dans le projet de Boulogne-sur-Mer, où ils sont venus habiter les lieux pour être en immersion, et comprendre au mieux ce qu’il se passait dans ce quartier-là.
P.L.B. : Exactement. Tout le travail de défrichage et d’expérimentation qu’a fait Bouchain est déterminant, pour nous c’est une référence. Sophie Ricard aussi, mais avec des difficultés – on l’a rencontrée – et ce n’est pas si simple et si merveilleux que ça apparaît dans les textes. Mais en tous les cas, cela, et le « permis de faire aujourd’hui », ce sont des questions que l’on travaille. Pour nous l’évolution des projets urbains vont dans ce sens-là, à part que Bouchain a anticipé le truc, et nous, on reprend ça à notre manière ici. Chacun le fait dans des contextes différents. Patrick Bouchain, c’est Patrick Bouchain, il va voir les maires pour négocier directement le truc. Il ne le fait pas s’il n’y a pas l’autorité du maire. Et il a raison, car de fait ça responsabilise le maire, et ça l’engage, c’est déterminant dans une commune, car c’est le maire qui a quand même l’autorité. Ce qu’on n’a pas pu faire pour Saint Pol pour des raisons politiques, je le fais aujourd’hui avec la commune de Téteghem, c’est-à-dire, que je suis en relation directe avec le maire. A partir de là, ça change beaucoup de choses.
L.V. : D’ailleurs, quelle est la position des institutions face à ce genre d’expérimentations, en sont-elles curieuses, ou sont-elles plutôt réticentes ?
P.L.B. : En général, les institutions restent assez figées dans leur fonctionnement, dans leur méthodologie… Par exemple, l’équipe du NPNRU de l’APUR, qui est composée de quatre personnes, super bien, cultivées, intelligentes, avec des bons parcours. Mais le problème, c’est qu’elles sont dans des fonctions hyper contraignantes. Bien que l’Anru affiche dans son NPNRU des obligations de participation des habitants, qu’est ce que ça veut dire concrètement ? C’est juste organiser des réunions, faire éventuellement une maison du projet, mais qui sera vide car personne n’ira. Néanmoins, on continue à avoir une forme de dialogue avec eux. On va peut-être renouer un partenariat d’ailleurs sur la question de l’agriculture urbaine. Enfin ça pourrait être, parce qu’à cause des élections d’une part et à cause du Covid d’autre part, sur Saint-Pol, ce projet est retardé pour le moment. On a fait deux nouvelles fiches-action, qui souhaitent intégrer l’appel à projet de l’Anru, sous le nom de « Quartier Fertile ». Regardez l’appel à projet sur le site de l’Anru si vous ne le connaissez pas.
L.V. : C’est donc pour vous un nouveau projet ?
P.L.B. : Oui, ça serait la poursuite du projet, mais on ne va pas construire des bancs toute notre vie non plus !
L.V. : Oui c’est pour aller plus loin que de la construction de mobilier urbain ?
P.L.B. : La construction de mobilier urbain est finalement un prétexte. Je veux dire, on n’est pas des aménageurs non plus. On fait peut-être du design, mais il est un peu éphémère, quoi ! Donc pour revenir au projet « Quartier fertile », l’appel a été lancé fin février-mars. Ici c’est la CUD qui va y répondre, mais potentiellement ça concerne tous les sites en rénovation urbaine de France. C’est un accompagnement de projet, autour de l’agriculture urbaine. Nous on le fait sur Saint-Pol, parce que tout le monde en parle de ces micro-fermes urbaines. Mais concrètement, Jean-Michel qui est un habitant, lui, pour nourrir sa famille, qu’est-ce qu’il fait ? Il squatte un terrain abandonné et puis il se fait une micro-ferme. Nous, on part de lui pour ce projet. La micro-ferme elle existe déjà en fait. Il y a plein de pratiques qui existent déjà.
L.V. : Finalement, on peut dire que vous avez un rôle d’accompagnateur de ces pratiques qu’on pourrait qualifier d’informelles.
P.L.B. : Oui on accompagne, on a un petit peu d’argent aussi, ça c’est important, d’avoir du financement. Et puis l’objectif c’est aussi que les gens se parlent, qu’ils ne fassent pas leur jardin chacun de leur côté, mais au contraire qu’ils créent un jardin plus collectif…
L.V. : Oui, comment créer un lieu d’échange de savoir-faire, de connaissances entre différentes personnes…
P.L.B. : Oui, ça c’est du co-design. Mais en partant de l’existant, c’est-à-dire une cité des cheminots abandonnée par le bailleur, des bâtiments qui sont des belles maisons des années 1920, qui sont détruites… Enfin c’est dramatique. Ah oui, et parmi les collaborations, on travaille avec les ateliers Médicis à Clichy, car un des membres d’Aman Iwan y est en résidence. Donc il y a un réseau qui s’est créé, à la fois du fait des fabriques de sociologie avec Pascal [Nicolas-Le Strat], et d’autre part autour de certains lieux, plutôt artistiques, comme les ateliers Médicis à Clichy, mais dans le cadre du renouvellement urbain qui a lieu aussi là-bas.
L.V. : Au fil des années vous parvenez à élargir votre réseau sur l’ensemble du territoire métropolitain ?
P.L.B. : Oui c’est ça, dès le premier projet par exemple nous avons travaillé avec les Saprophytes, le collectif lillois d’architectes-paysagistes-plasticiens. On est aussi associé à ce réseau par eux, sur la question de « comment faire administration des communs ? ». On travaille aussi cette question des communs. Donc on est isolé sur le territoire dans notre manière de faire, mais on est en réseau parce que d’autres territoires ont en train de faire des choses aussi. On travaille aussi avec le réseau de sociologie sur l’initiative à Lyon. On est en contact avec Marseille sur un autre volet… Aujourd’hui on voit apparaître beaucoup d’initiatives avec ce qu’a transmis Bouchain, l’émergence de certains collectifs comme ETC, et d’autres encore. On est une nouvelle génération aujourd’hui. Ils sont trop institutionnalisés, les autres. Ils sont morts ! [rires]
[1] Mémoire soutenu en 2021 dans le cadre du séminaire Constellations_Architectures du commun (dir. E Doutriaux & C Menezes-Ferreira, à l’Ensa Paris-Val de Seine).
[1] Catherine Rannou est architecte et artiste, enseignante à l’Ensa Paris-Val de Seine.
[2] Créée en 2003 par Jean-Louis Borloo, alors ministre délégué à la Ville, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (Anru) pilote et finance le Programme National de Rénovation Urbaine, doté de plus de 12 milliards d’euros. Très vite des centaines de chantiers de démolition et reconstruction de logements sont lancés dans toute la France. […] En 2014, dans le cadre de la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le Gouvernement annonce la création du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, toujours piloté par l’Anru. 450 quartiers de la Politique de la Ville feront l’objet, d’ici à 2030, d’une transformation globale. L’Anru finance et accompagne les collectivités et les bailleurs sociaux pour mettre en œuvre de vastes projets de rénovation des quartiers les plus vulnérables. Il s’agit de transformer ces quartiers en profondeur, en intervenant sur l’habitat, mais aussi en les désenclavant et en favorisant la mixité sociale. » Cet extrait du site de l’Anru (in https://www.Anru.fr/presentation-de-lAnru _ consulté le 08/10/2021), ne dit évidemment pas les critiques adressées aux méthodes régaliennes, à l’absence de concertation, et à la relative brutalité (politique de démolition systématisée) dont fait l’objet cet organisme. Cela dit l’intérêt de la démarche symétriquement inverse de l’En Rue, qui procède en quelque sorte de la rue, et avec le concours des habitants.
[3] On le verra plus loin, une équipe de chercheurs en sciences sociales, composée de Martine Bodineau, Louis Staritzky et Pascal Nicolas-Le Strat (réseau des Fabriques de sociologie et Territoires en expérience(s), axe du laboratoire Experice – Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis), sera bientôt associée au projet En Rue. Elle éditera un blog à ce sujet : https://fabriquesdesociologie.net/EnRue/author/pascal/ [consulté le 07/10/2021]
[4] Voir note 2 supra.