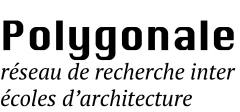Pour introduire notre participation à ce séminaire pédagogique et de recherche inter-école, nous pourrions nous appuyer sur son intitulé : Formes et imaginaire du commun.
Avec ses références proposées: les « permanences architecturales » de Sophie Ricard et Patrick Bouchain, jusqu’aux expérimentations d’auto-construction de Notre Dame des Landes.
Ce thème du commun, dans ses formes et son imaginaire pose aussi la question du rôle de l’architecte et des formes qu’il produit.
Cette question du rôle de l’architecte a été posée par notre collègue enseignante Kantuta Quiros lors de sa première intervention dans le studio de projet muter habiter penser. Il s’agissait de questionner les indicateurs des rapports de forces lisibles dans les formes spatiales de l’architecture et de la ville. C’est-à-dire ce que la forme construite nous dit de la société, de ses autorisations et de ses aliénations.
Par exemple : les passages piétons, les garde-corps, les entrées de service, les unités de passage, les traitements d’air, ce qui nous tient à distance et ce qui nous autorise…
Comment aborder le rôle de l’architecte différemment de celui que nous connaissons habituellement, c’est à dire comme celui d’un prestataire au service d’un commanditaire ?
Dans cette discussion dans le studio, est apparu le terme d’architecte intercesseur. De celui qui créé un intervalle de pensée et en même temps rapproche des points de vue différents. (en s’emparant des modalités de la commande – en faisant d’une recherche un programme du commun – un impensé qui devient évidence)
Et ceci par la production d’une forme architecturale construite.
Dans cette question du commun, on pourrait-on aussi lire une sorte d’idéal, d’universalisme ?
Dans le studio de projet de master à l’ensa Nantes, porté par Léa Mosconi (architecte et Docteur en architecture), Kantuta Quiros (Docteure en arts et sciences de l’art) et Romain Rousseau (architecte), nous avons d’emblée posé l’hypothèse que le concept d’universel est en soi un paradigme, c’est à dire une certaine vision construite du monde.
L’universel, en effet, ne va pas forcement de soi.
C’est un concept qui arrange ceux qui croient dans la répétition, dans la légitimité d’un pouvoir omnipotent, dans la séparation des catégories, dans la limpidité de la vérité.
Par contre, c’est un concept qui dérange ceux qui croient aux valeurs de la différence et du doute.
Dans le studio de projet muter habiter penser, c’est le point que nous souhaitions interroger.
De quels paradigmes sommes nous construit ? Peut-on déconstruire certains de ces paradigmes pour explorer/libérer notre champ opératoire : celui de l’architecture ?
Quelles sont les fictions théoriques (Kantuta Quiros) qui sous entendent nos manière de penser (l’architecture) ?
En particulier, à la suite des travaux de Bruno Latour, comment aborder l’hypothèse d’un changement ou d’une actualisation de ces paradigmes : la nature, le genre, les catégories, les dualismes, les champs disciplinaires, le commun, etc… ?
Nous avons posé l’hypothèse du dualisme comme un indicateur de rapports de forces et le fait qu’à chaque fois que se met en place un rapport de force, un rapport de domination est mis en place. Et nous nous posons cette question de savoir, dans cette relation, à qui profite le crime ? (c’est aussi la question du privilège? – antagonisme du commun)
Pour essayer de penser cela, nous avons réfléchi aux différences entre paroles dominantes et paroles subalternes et comment tenter de déconstruire les emprises subies dans nos désirs d’agir (avec l’architecture).
Nous avons pour cela convoqué de manière probablement abusive et sauvage plusieurs concepts : (entre autres) ceux de décolonisation, de cosmogonie et d’architecture queer.
Décolonisation comme expression du dés-asservissement de la domination d’un groupe d’individus, ou d’un groupe de pensées à l’encontre d’un autre groupe moins audible, moins visible, plus subalterne.
Par exemple comment décoloniser le logement social issu de l’emprise de l’architecture moderne ?
Cosmogonie, (que nous avons emprunté à Augustin Berque, Recosmiser la Terre, Quelques leçons péruviennes, ed B2) et que nous nous sommes permis de considérer comme transcalaire et situationnel. Par exemple la forme urbaine de l’impasse comme une cosmogonie, avec ses manières de faire, ses croyances, ses lois, ses émotions, ses représentations. En réalisant que chaque projet d’architecture s’empare d’une cosmogonie et l’actualise, la décentre, la déséquilibre, la détruit, la fait bifurquer ou la renforce.
Architecture queer, que nous n’avons jamais réussi à identifier : « étrange », « bizarre », « tordue », comme quelque chose à penser de manière différente et comme différence de ce que l’on pourrait habituellement penser comme ayant toujours déjà été là.
Essayer de penser que les choses que nous pensons, que nous voyons, n’ont pas toujours été déjà-là, cela nous permet de penser l’instabilité, la mutation, le mouvement. Autant pour ces questions liées au corps qu’à des manières de concevoir un projet d’architecture et pourquoi pas de construire l’architecture.
Après l’apprentissage d’outils et de méthodes de travail dans le cycle licence, le cycle master dans les écoles d’architecture doit se donner l’ambition de poser ces grandes questions contemporaines par la recherche, par la pratique, par le projet, mais toujours avec l’architecture comme médium.
C’est ce qui nous différentie des philosophes, des artistes, des écrivains, des acteurs politiques.
Dans cette hypothèse de travail autour des fictions théoriques et des changements de paradigmes, plusieurs thématiques étaient proposées en début de semestre : les savoirs, la culture, l’esthétique, le politique, l’habitation et le commun.
Le travail individuel et collectif des étudiants a vite montré que l’entrée thématique était elle-même le fruit d’une logique universitaire disciplinaire et que si nous devions aborder l’hypothèse de changement de point de vue, la méthode devait elle aussi muter.
Deux semaines après le début du studio de projet, nos propres hypothèses pédagogiques étaient déjà mise à mal. Ça promettait.
Nous avons donc établi une première cartographie des sujets proposés par chacun des 32 étudiantes et étudiants, de master 1 et 2 et de master PFE.
Nous nous sommes aperçu que ces sujets personnels ne pouvaient s’imaginer que dans la traversée de multiples récits fictionnels, et que au fur et à mesure de l’avancée du travail, ces traversées allaient constamment se ré-agencer.
En début de semestre d’automne, au mois de septembre :
- Commun / communauté
- Esthétique
- Ontologie de l’inconfort
- Architecture depuis l’intérieur
- Risque / milieu
- Epistémologie de l’architecture
- Architecture post-coloniale
puis, en décembre :
- Politique
- Commun(s)
- Corps
- Emotion esthétique
- Epistémologie de l’architecture
- Re-cosmogonisation
- Milieux
- Vivan
- Architecture post-coloniale
- Genre
Le projet d’architecture comme nouvelle fiction re-configurante des questions posées pouvaient se lire comme le barycentre des pré-occupations de chacun et chacune, mais les territoires de pensée en jeu étaient plus complexes, inter-agissants et s’auto-alimentant les uns les autres.
Ces territoires de pensée, en même temps porté par la « commande » (faire un projet d’architecture de niveau master en 192 heures encadrées et 250 heures personnelles pour les PFE) et en même temps par l’engagement intellectuel de chaque étudiant, pouvait ainsi se présenter comme une zone fictionnelle d’interaction, par un nuage de forces et de ressources mises au travail.
Une sorte d’éco-système du projet, un imaginarium pourrait-on dire. Ou encore une cosmogonie. (l’architecture sert à formaliser des imaginaires)
C’est à dire l’ensemble des récits, des paradigmes, des fictions théoriques, des apports scientifiques, des émotions, des expériences et expérimentations qui forment le cadre de réflexion, de représentation, de conception et de fabrication du projet. (Nous avons aussi emprunté sauvagement la notion de « somathèque » proposé par Paul. B Préciado).
Mais le plus indispensable dans une école d’architecture, dans la formation des architectes, c’est bien la production de la forme architecturale et urbaine, quelle qu’en soit l’échelle et l’usage.
De là, les 4 travaux de Camille Doll, Sarah Pasquier, Fabio Prévitali et Matthias Rigou, ne sont pas des exemples applicatifs de cette expérimentation pédagogique, mais le résultat d’expérimentations architecturales portées par de jeunes architectes engagés dans la mutation de paradigmes peut-être devenus obsolètes.
Là où il serait question de :
- Comment représenter le monde afin de pouvoir y agir ?
- Comment penser la décolonisation du corps en architecture ?
- Binarités, comment dépasser les frontières conceptuelles et spatiales
- Les formes architecturales de l’accueil du vivant ?